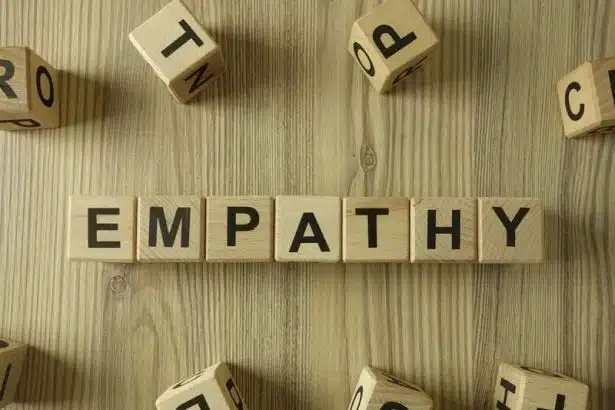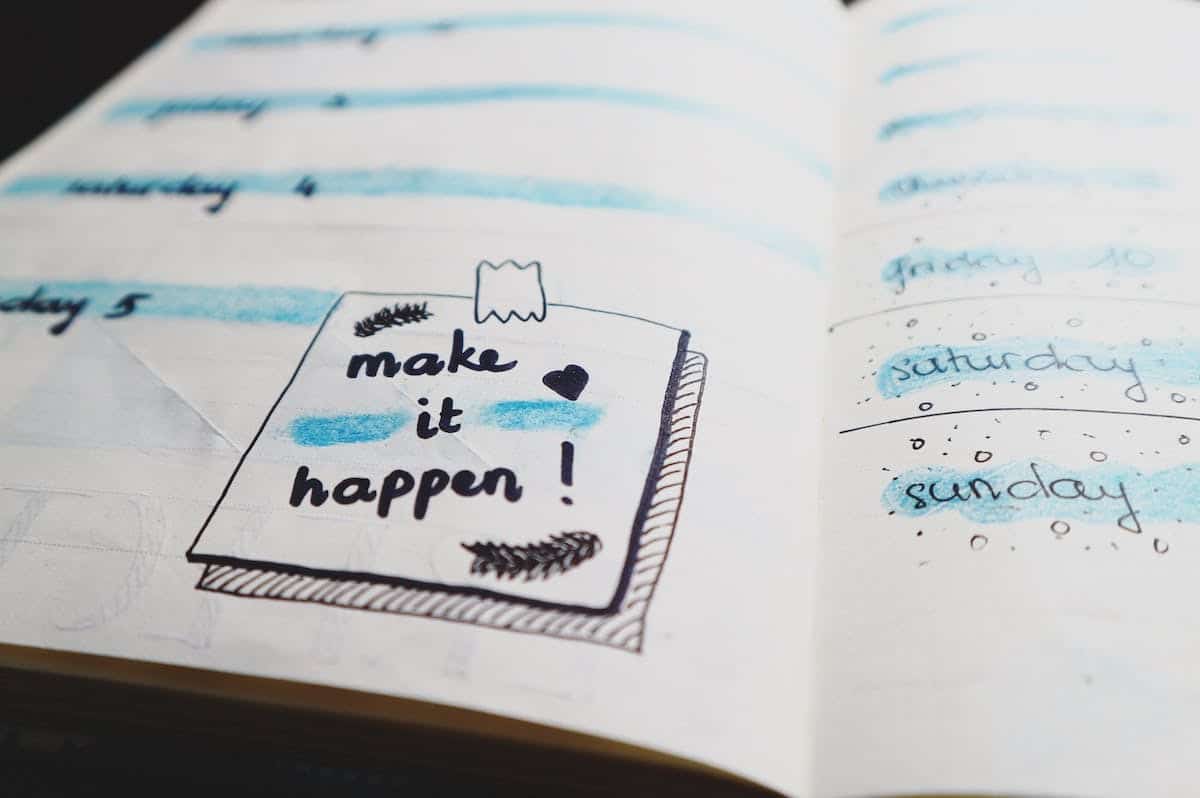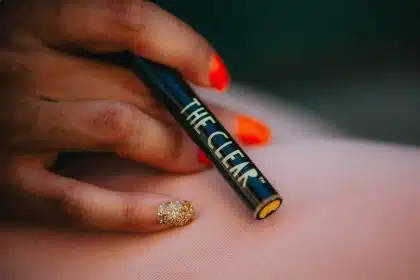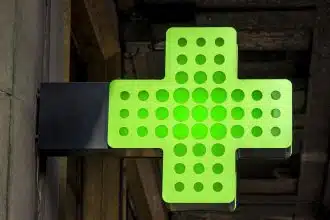Stratégies pour trouver une crèche privée de qualité à Lyon
Le choix d’une crèche est souvent privilégié par les parents, mais comprendre…
Les clés pour gérer efficacement le stress pendant la grossesse
La grossesse, un moment unique dans la vie d'une femme, peut souvent…